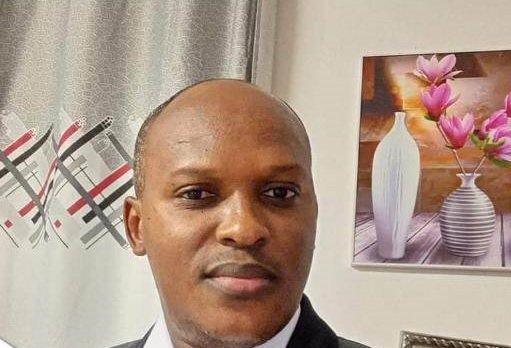L’expression « exercice régulier des fonctions » utilisée à l’article 74 du projet de Constitution cristallise un débat d’interprétation à la fois juridique et politique. Contrairement à certaines lectures alarmistes, cette formulation constitue une balise normative fondamentale, propre à encadrer l’immunité accordée aux anciens présidents de la République.
D’un point de vue doctrinal, le qualificatif « régulier » renvoie à l’exercice des fonctions dans le strict respect des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, ainsi que des obligations inhérentes à la charge présidentielle. L’immunité ainsi prévue ne saurait couvrir les actes manifestement arbitraires, les violations délibérées des droits fondamentaux, les abus de pouvoir, ou encore les détournements à des fins personnelles.
Ce texte n’instaure donc ni une immunité absolue, ni une irresponsabilité générale, mais opère une distinction essentielle entre actes institutionnellement fondés et actes délictueux détachables de la fonction.
Par ailleurs, le projet constitutionnel introduit des mécanismes de redevabilité renforcés :
- La création d’une Cour spéciale de justice, compétente pour juger le président en exercice, ce qui constitue une innovation notable ;
- Une définition restrictive et juridiquement encadrée de la haute trahison, permettant d’éviter une instrumentalisation politique de cette notion ;
- Une procédure de révocation populaire par référendum, à l’initiative des citoyens, assurant une forme de souveraineté directe et de contrôle démocratique.
Toutefois, la portée effective de ces dispositifs dépendra, in fine, de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de la capacité des institutions à garantir la séparation des pouvoirs, et de la culture juridique dominante. L’histoire récente a montré les limites pratiques des garanties juridiques en l’absence de volonté politique : la déclaration des magistrats, postérieure au changement de régime de 2021, selon laquelle ils auraient été « empêchés de dire le droit », en est une illustration éloquente.
En définitive, le terme « régulier » ne saurait être interprété comme un blanc-seing, mais comme une ligne de démarcation conceptuelle entre la légalité fonctionnelle et l’abus de pouvoir. Sa correcte interprétation, consolidée par la jurisprudence et la doctrine, est indispensable pour éviter que l’immunité ne se transforme en impunité.
Il revient donc au législateur organique, aux juridictions constitutionnelles et au corps judiciaire dans son ensemble de veiller à l’effectivité de cette nuance, pierre angulaire d’un État de droit crédible et responsable.
Mamadou Aliou BAH
Juriste publiciste
Lire l’article original ici.